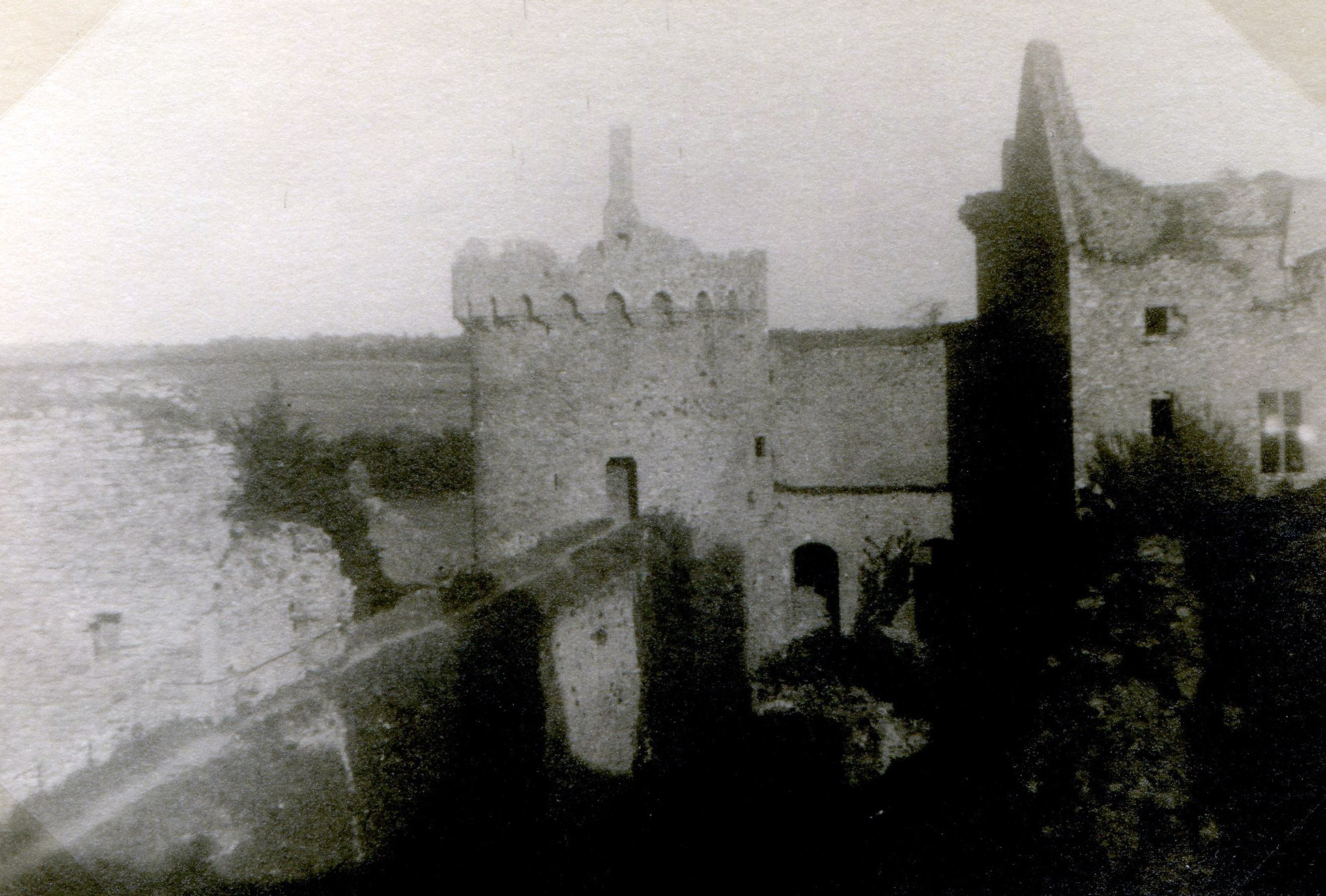29 – 30 Août 1948 – Presqu’ile de Rhuys

Voilà deux mois que je suis en garnison à Saumur et j’ai déjà visité pas mal de coins de l’Anjou. Aussi, cette fois, j’ai vu plus grand et j’ai décidé une escapade de 48 heures en Bretagne. Prétextant des fiançailles, j’ai obtenu les deux jours nécessaires pour passer suffisamment de temps au bord de la mer.
Ce qui explique que ce soir là je quitte l’Ecole de Cavalerien en tenue n°2 : celle que je réserve pour mes randonnées. En effet, elle passera le weekend roulée en boule au fond de mon sac à dos et il est inutile que je réserve ce que j’ai de plus smart à cet usage.
Je vais jusqu’au garage où j’entrepose mon matériel, j’enfourche ma pétrolette (ma « pette-à-roue » comme l’appelle un copain) et, sac au dos, je file vers la gare, car je manque de temps pour faire le voyage entier par la route, et prends le train jusqu’à Pornichet.
A Angers, premier changement de train. Je vais au fourgon à bagages pour vérifier si mon vélo moteur suit bien. Heureuse précaution ! On m’apprend qu’il ne voyagera que par le train suivant. Autrement dit il n’arrivera à Pornichet à je ne sais quelle heure pendant que je me morfondrais à l’attendre. Je baratine désespérément et arrive à le faire admettre en « bagage accompagné ».
A Nantes, deuxième correspondance et comme je dois maintenant emprunter une micheline plutôt pleine où l’espace vital est très restreint j’entrevois des difficultés sérieuses pour mon engin. Nouveaux palabres, mais la partie est dure ! Je feins la résignation et m’embusque à la dernière portière (la plus éloignée du chef de convoi). Puis au coup de sifflet de départ, j’empoigne ma pétrolette et la hisse, non sans mal dans la micheline où les voyageurs d’abord étonnés puis aimablement compréhensifs me donnent un coup de main. Nous roulons et mon matériel est au complet ! Merci Seigneur !
Je suis dans la situation du passager clandestin qui, en se révélant en pleine mer, espère que l’on ne le jettera pas par-dessus bord. C’est ce qui se passe, le contrôleur est bien un peu estomaqué de me voir avec ma pette-à-roue dans une micheline qui est réservée aux voyageurs munis de bagages légers, mais il ne me fait pas de reproches sérieuses. Sauvé !
Je débarque à Pornichet à minuit passé, et, en moto, je pousse vers un emplacement de camping autorisé et assez mathieux mais qui a le mérite de m’être connu, d’être aisément repérable en pleine nuit et d’être d’un accès facile aux motorisés. C’est là que Monsieur Richard et sa femme ont passé leurs vacances et m’ont invité il y a un mois environ.
Je monte ma tente dans la nuit tiède et m’endors bientôt bercé par le bruit de la mer qui roule à 200 mètres et celui du vent dans les pins ce qui fait oublier la proximité des maisons et les ruines du mur de l’Atlantique que je devine dans la nuit.

Le lendemain matin je me lève d’assez bonne heure et, ma tente pliée, le sac arrimé sur la moto je suis prêt à partir quand sort de sa tente le campeur voisin qui partageait avec moi ce grand camp désert. Il est là depuis quelques jours avec sa femme et un jeune garçon : nous échangeons quelques mots avant mon départ.
J’ai gardé ma tenue militaire en draps car le temps est couvert et en roulant je n’ai pas trop chaud. La pétrolette est vraiment un merveilleux instrument pour se refroidir.
Je quitte la côte à la Baule-Escoublac et roule vers Herbignac. La route fantaisistement empierrée est pittoresque et le pays traversé me familiarise avec la Bretagne que je ne connais presque pas. Terre assez pauvre où partout le genet apparaît sur le sable. Quelques petits hameaux dont les maisons noires et blanches (granit et eau de chaux) sont parfois coquettes mais inspirent toujours malgré tout une confiance limitée quant à la propreté de leurs habitants car partout le sol est fangeux des fumiers qui s’étalent à quelques mètres des demeures.
Je rejoins bientôt la route nationale, et, après une quarantaine de kilomètres, je parviens à la Roche Bernard où la Vilaine mérite peu son nom, encaissée, bien que très large, par ses berges rocheuses, taillées en falaises, et couronnées de pins maritimes.
La rivière est franchie par un pont de bateaux, solidement amarré, car le flux remonte largement jusqu’ici et le courant change de sens à chaque marée. A gauche, les débris du viaduc sauté gisent encore dans l’eau sale. Car comme tous les fleuves côtiers de la région que remonte la marée, la Vilaine a, près de son embouchure tout au moins, une eau trouble et grise.
J’abandonne la large route goudronnée pour un chemin sinueux et très pittoresque serpentant dans des paysages qui rappelle parfois Fontainebleau. Traversée de hameaux très pauvres d’apparence, puis arrivée à Billiers où je revois la mer : désillusion : côte plate quand non vaseuse que faisait, à vrai dire, pressentir les multiples marécages plus ou moins prés salés remontés auparavant.
Par Muzillac (bizarres ou tout au moins imprévus ces noms en « ac » qui sonnent gascons !) je continue vers la presqu’ile de Rhuys au sud de Vannes. J’arrive à St Gildas de Rhuys dont le nom m’enchante et où, indice plus sérieux, j’ai lu sur la carte : pointe du Grand Mont. Voilà qui suppose une côte moins plate que les autres. Car pour la randonnée pédestre que je compte commencer maintenant j’espère rivage un peu rocheux et découpé.
Je laisse mon engin garé dans un hôtel restaurant du patelin où flotte une odeur très tentatrice de mangeaille succulente. Or il est midi passé et depuis le déjeuner de ce matin (qu’il est loin) je n’ai rien mangé… Héroïque, je pars l’estomac vide ne voulant m’enmathieuser dans cette hôtellerie. Quelques achats de vivres et en route vers la mer à pied, cette fois.
Merci Dieu, la côte est rocheuse et découpée comme je le souhaitais. Le ciel est couvert par moments et les nuages, chassés par le vent, fuient le large. Atmosphère parfaitement bretonne.
Au point de vue prosaïque du cuisinier c’est moins bien car le pays est assez nu et comment faire un feu utilisable avec ce zeff ? Je décide de longer la côte vers la gauche où elle parait le plus pittoresque. Après peu de temps de marche l’équipement motocycliste se révèle trop chaud et je me mets en short. Bientôt j’ai la chance de trouver un bois minuscule en bordure de la mer où je m’installe pour déjeuner à l’abri du vent.
Quelques pierres, un peu de bois et bientôt je puis espérer un repas chaud.

Les arbres de ce coin sont bizarres, et par la suite je verrais que c’est l’espèce ( Il s’agissait de Tamaris) la plus répandue par ici. Leur aspect rappelle les arbres méridionaux : mi-ciprès, mi-pins. Leurs basses branches semblent mortes mais restent souples et témoignent ainsi qu’il n’en est rien. Le bois mort est presque rare. En tous cas leurs formes tourmentées par le vent sont bizarres et on imagine fort bien des Korikans folâtrant parmi eux au clair de lune.
Le déjeuner terminé je repars en longeant toujours la côte.
Une petite station balnéaire d’arrière-saison, une marchande de friandises seule avec son éventaire, deux ou trois estivantes qui espèrent un dernier sursaut de l’été, frileusement engoncés dans des pull-overs. C’est tout.
Bientôt, après un minuscule port où trois bateaux-jouets se racontent des histoires de pêche, c’est une côte sauvage et nue. Une herbe rase couvre des mamelons qui tombent soudain à la mer en montrant le sous-sol rocheux à peine recouvert d’une mince couche de terre pauvre.
Parfois l’on découvre une petite crique sableuse où s’amasse le goémon.
Soudain il bruime et j’ai à peine le temps de mouiller ma cape imperméable que c’est fini, et que le soleil, un peu boudeur, se remet de la partie, par intervalles.

Je dépasse un port à peine plus important que le premier et où quelques marins font mine de s’occuper.
Puis c’est une côte basse et sableuse où la culture s’arrête, comme à regret, à quelques mètres de la mer.
Maintenant que j’ai dépassé les maisons soigneusement alignées en une rue unique de je ne sais quel village, je commence à apercevoir les ruines du château de Suscinio que je compte visiter et qui marquera, hélas, le terme de ma randonnée car il me faudra faire demi-tour avant ce soir de retour en vélo-moteur présentant toujours des risques de pannes et une marge de sécurité est à prévoir.
Je marche maintenant entre la mer et un marais plus ou moins asséché recouvert de longues herbes ondulantes que l’on fauche par endroits.
Et enfin voici le château en ruine que je visite tranquillement tout seul, le guide n’ayant pour mission que d’ouvrir la porte. Dominant, non sans peine, un vertige qui me couvre de sueur, je monte sur les remparts d’où l’on voit assez loin un pays plutôt plat d’ailleurs.
L’heure avance et je me demande où planter ma tente : les environs sont très plats et de peu d’intérêt avec ce vaste marécage. Si je campais dans la cour du château ? J’y renonce malgré l’originalité de l’assemblage d’une itisa dans une cour d’honneur d’un château moyenâgeux car j’ai envie de camper en vue de la mer : je décide de filer à marche forcée vers un coin repéré à l’allée mais qui est assez éloigné.
J’y arrive à la tombée de la nuit : à quelques mètres de la mer sur une dune basse à peine recouverte d’une herbe aussi courte qu’une moquette trois de ces arbres étranges esquissent un bosquet. Je monte ma tente avec précaution car il vente ferme et les tendeurs sont secoués avec rage.
Un feu polynésien enterré me permettra, à l’abri d’un vague buisson, de cuisiner malgré le vent qui se lève de plus en plus.

Toute la nuit il sifflera et secouera ma tente.
Le lendemain matin me voit faire le même chemin que la veille. Je pourrais évidemment revenir par un itinéraire différent en passant par l’interland mais l’intérieur je le verrai tout mon saoûl en pétrolette tandis que la côte ! L’ambiance est d’ailleurs très différente de la veille car le vent est tombé, le ciel est assez pur et la marée basse ce matin.
De retour à Saint Gildas de Rhuys, je retrouve ma pétrolette (garée gratuitement m’annonce avec générosité la patronne de l’hôtel), j’expédie quelques cartes postales et reprends ma route vers le sud.
Je passe par certaines trances car mon niveau d’essence baisse dangereusement sans que je puisse me ravitailler n’ayant pas de bons et les garagistes se montrant intraitables sans ces précieux bouts de papier. Enfin à la Roche-Bernard, un philanthrope m’en « donne » cinq litres pour le prix d’un vélo d’avant-guerre. Merci quand même.
A Herbignac au lieu de prendre la même route qu’à l’aller je bifurque sur Guérande pittoresque ville encore entourée de ses vieux remparts et dont l’église m’émerveille.
C’est ici que je suis censé passer ma permission pour me fiancer et j’ai bon nez d’y aller réellement car, outre qu’il eut été dommage de méconnaître cette jolie ville, mon capitaine, signataire de la permission, me demandera des tuyaux sur l’endroit. Un peu de mémoire et d’imagination et je m’en sortirai.
Puis c’est la fin du retour motorisé après un crochet par Batz et le Pouliguen où je prends pas mal de photos de la mer très pittoresque sur cette côte aux falaises claires.
A la Baule je passerais encore une heure agréable avant de me réembarquer dans le train à nouveau déguisé en militaire après avoir joué les Frégolis dans une arrière salle de café.
Et je me remémore mon précédent repas dans les pins alors que ce soir je casse la croute sur le quai de la gare !
Que de bons souvenirs j’ai fait provision pendant cette escapade et me voici prêt à retrouver la vie peu intéressante du troufion avec un courage ou plutôt une patience nouvelle.